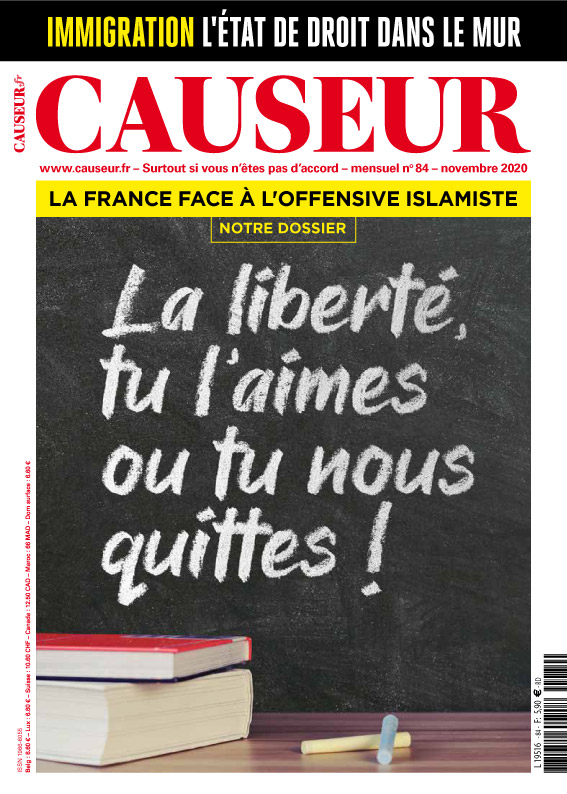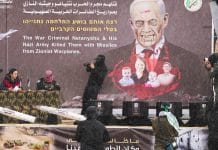Après des décennies de violence on ne peut plus dire que l’islam n’a rien à voir avec l’islamisme. Chaque attentat met en évidence une cascade de complicités allant de la relativisation à l’apologie, de l’indulgence à la justification, le tout enrobé d’un complotisme victimaire.
« Ici les gens sont tranquilles, pas genre djihadistes, encore moins terroristes. Mais à l’intérieur d’eux, une petite voix leur souffle que condamner le voyage en Syrie serait un peu se trahir et qu’une fille portant le voile sera toujours mieux que celle aimant la fête. »
C’est ainsi qu’une jeune musulmane âgée d’une trentaine d’années décrit dans Le Monde, quelques jours après l’attentat du Bataclan, l’ambiance à Clichy-sous-Bois. Elle était amie avec Hasna Aït Boulahcen, tuée pendant l’assaut des forces de l’ordre à Saint-Denis contre la planque de son cousin, Abdelhamid Abaaoud, planificateur présumé des attentats du 13 novembre. La jeune femme parle de « gens tranquilles », ceux qu’on évoque sur les plateaux de télé comme « des Français comme vous et moi », qui ne pourraient pas faire de mal à une mouche. La diversité, la nouvelle petite classe moyenne intégrée, des gens sans histoire, ni terroristes ni fichés S. Sauf que beaucoup entendent une petite voix intérieure qui instille en eux le rejet de leurs concitoyens non musulmans et de leurs mœurs. Cette petite voix les empêche de condamner sincèrement chez eux, hors caméras, devant leurs enfants et leurs proches, ces autres, pas tranquilles du tout, qui tuent leurs concitoyens.
À lire aussi: Les Français exigent des actes contre les islamistes qui les menacent sur leur sol
Djihadistes, islamistes, musulmans : ces trois cercles concentriques sont-ils intrinsèquement liés ?
Samedi 17 janvier 2015, dix mois avant les attentats du Bataclan et dix jours après ceux qui ont frappé la rédaction de Charlie Hebdo. À la Grande Mosquée de Paris, centre historique de l’islam traditionnel, des adultes suivent, tous les samedis et dimanches, de 9 heures à 19 heures, une formation d’imam ou d’aumônier.
Les 10 et 11 janvier, ces cours avaient été suspendus. Une semaine plus tard, Ariane Chemin et Anna Villechenon, deux journalistes du Monde, y assistent à une séance où les élèves imams sont invités à échanger autour des « événements », terme qui désigne en ce lieu les attentats des 7, 8 et 9 janvier – et qui, volontairement ou pas, rappelle la grammaire de la guerre d’Algérie. Les journalistes le constatent très vite : « Personne ici ne se sent Charlie. » Le formateur, Missoum Chaoui, aumônier pénitentiaire en Île-de-France, non plus. Il encourage ses étudiants à ne pas laisser dire que les attentats ont été commis au nom de l’islam, ou au nom de Mahomet. « Ouvrez vos pages Facebook, allez sur Internet. Ils ont sorti leurs plumes empoisonnées,